- Accueil
- Blog
Blog
La peur de l'abandon : explications !
Le 05/10/2024
La peur de l’abandon est un thème central dans le champ de la psychanalyse, car elle touche au cœur des dynamiques inconscientes qui structurent la relation à l'autre et au soi. En psychanalyse, cette peur est souvent analysée en relation avec les premières expériences de séparation, notamment celles vécues avec les figures parentales, et elle se manifeste dans des angoisses profondes liées à la perte d’amour ou de sécurité. Explore la peur de l’abandon à travers plusieurs concepts psychanalytiques centraux, en se basant sur les travaux de Freud, Melanie Klein, Winnicott et Bowlby.
La peur de l'abandon et la psychanalyse freudienne
Freud (1915) a exploré les racines des angoisses fondamentales dans ses travaux sur l'inconscient, en particulier dans ses théories du développement infantile. Dans "Inhibition, Symptôme et Angoisse", Freud introduit la notion d’angoisse primaire, qu'il relie à l’expérience de séparation d’avec la mère. Cette angoisse originelle constitue une base pour comprendre la peur de l’abandon. Freud théorise que le premier lien entre l'enfant et sa mère est essentiel, car c'est la mère qui satisfait les besoins primaires de l’enfant. Lorsqu’il y a une séparation, l'enfant peut ressentir une profonde détresse. La rupture de ce lien est alors vécue comme un abandon, une perte d’objet (la mère en tant qu'objet d'attachement). Freud a également souligné l'importance de la "perte de l'objet d'amour" qui, dans son modèle pulsionnel, est un thème récurrent dans le développement de la névrose. L’enfant, privé de cet amour, peut développer une angoisse qui se manifeste plus tard sous diverses formes. L’idée centrale est que la peur de l’abandon est intimement liée à la perte de l’objet d'amour.
L’angoisse de persécution et l'angoisse dépressive
Melanie Klein (1935) a étendu la compréhension des processus inconscients chez l'enfant, notamment à travers l'idée de positions psychiques. Pour Klein, la peur de l'abandon est liée à deux formes d'angoisse : l'angoisse persécutrice et l'angoisse dépressive, qui caractérisent respectivement la "position paranoïde-schizoïde" et la "position dépressive" chez l'enfant. Dans la position paranoïde-schizoïde, l'enfant projette ses sentiments agressifs et destructeurs sur l'objet (la mère), ce qui crée une angoisse persécutrice. L'enfant craint que l'objet ne revienne pour le persécuter ou le détruire. Par extension, cette peur peut se transformer en une peur d’être abandonné par cet objet si investi, car l’enfant craint que sa propre agressivité ne l’ait détruit. Dans la position dépressive, l’enfant commence à percevoir l’objet comme étant entier, à la fois bon et mauvais. L’angoisse de persécution se transforme alors en angoisse dépressive : l'enfant craint d’avoir endommagé l'objet d’amour à cause de ses impulsions destructrices. Cette culpabilité conduit à une peur plus subtile de l’abandon, car l’enfant ressent une angoisse liée à la perte de l'objet entier (la mère) qu'il aime et déteste à la fois. Cette compréhension kleinienne nous permet de voir comment la peur de l’abandon est non seulement liée à la séparation physique, mais aussi à une séparation psychique interne due à l’agressivité et à la culpabilité.
L’objet transitionnel
Winnicott (1953), en s’intéressant à l’individuation et au développement émotionnel de l’enfant, a proposé la théorie des objets transitionnels et de l’espace transitionnel. Selon lui, la peur de l’abandon est fortement liée à l'expérience de séparation progressive entre l'enfant et sa mère. Winnicott souligne que l’enfant, dans les premiers mois de sa vie, ne distingue pas clairement entre lui-même et le monde extérieur. Il vit dans une sorte de fusion avec sa mère. La tâche développementale majeure est alors de permettre à l'enfant de se séparer progressivement de la mère, tout en maintenant un sentiment de sécurité interne. C’est là que l’objet transitionnel (comme un doudou, une peluche) joue un rôle crucial, car il permet à l'enfant de tolérer la séparation sans vivre une angoisse trop écrasante. Cet objet devient un substitut temporaire de la mère, facilitant ainsi l’autonomisation progressive. Dans cette perspective, la peur de l’abandon peut surgir lorsque ce processus de séparation ne se passe pas en douceur, soit parce que la mère est trop absente ou, au contraire, trop présente, empêchant ainsi l'enfant de développer un sens solide de soi. Si l’enfant ne peut pas internaliser un "objet bon" suffisamment sécurisant, il est condamné à vivre des angoisses d'abandon récurrentes, cherchant constamment un objet externe pour apaiser son anxiété.
L’attachement
La théorie de l’attachement développée par John Bowlby (1969, 1973) offre une autre perspective psychanalytique sur la peur de l’abandon. Bowlby, bien qu’influencé par Freud et Klein, a développé une approche fondée sur l’observation des interactions réelles entre les enfants et leurs figures d’attachement, principalement la mère. Pour Bowlby, les premières expériences d’attachement sont cruciales pour le développement de la personnalité et influencent la capacité à former des relations sécurisantes à l’âge adulte. Un attachement sécurisant, où l’enfant sait que sa figure d’attachement reviendra toujours, permet à l’enfant de développer une confiance fondamentale. En revanche, un attachement insécurisant, où la présence de la mère est imprévisible ou incohérente, entraîne chez l’enfant une peur constante d’être abandonné. Bowlby a identifié plusieurs styles d’attachement, dont l’attachement anxieux-ambivalent, où l’enfant développe une peur chronique de l’abandon à cause d’une figure d’attachement imprévisible. À l’âge adulte, cette peur se manifeste souvent par des comportements de dépendance, un besoin excessif de réassurance et une peur constante de perdre les relations importantes.
Le narcissisme et la peur de l’abandon
La psychanalyse a également exploré la peur de l’abandon dans le cadre des troubles narcissiques. Dans ses travaux sur le narcissisme, Freud (1914) a proposé que l’amour-propre ou narcissisme est une forme d’attachement à soi-même qui est une réponse au risque d’abandon. L’enfant, dans ses premiers mois, est centré sur lui-même. C’est ce que Freud appelle le narcissisme primaire. À mesure que l’enfant se développe, il commence à déplacer une partie de cet amour-propre vers des objets externes, principalement ses parents. Si ce déplacement est entravé, par exemple par une figure d’attachement trop instable ou absente, l’enfant peut retourner à un état de narcissisme primaire comme défense contre la peur de l’abandon. Dans les cas de narcissisme pathologique, la peur de l’abandon est particulièrement aiguë. Le narcissique cherche désespérément à être aimé et admiré par les autres pour combler un vide interne. Cependant, ce besoin compulsif d'attention masque une fragilité sous-jacente : la personne narcissique craint constamment d’être rejetée ou abandonnée. L’amour des autres est essentiel pour maintenir une image idéalisée de soi, et toute menace d'abandon est vécue comme une blessure narcissique.
Le manque fondamental
Jacques Lacan a abordé la question du manque et du désir comme centrales à l’expérience humaine. Pour Lacan (1959), le désir humain est toujours marqué par une quête de complétude, une complétude qui reste à jamais hors de portée. Le désir est lié à ce qu'il appelle "l’Autre" (l’Autre symbolique), une figure qui incarne le manque fondamental autour duquel se structure la subjectivité. Dans cette optique, la peur de l’abandon peut être vue comme une manifestation du désir insatiable de combler ce manque originel. L’être humain, selon Lacan, est fondamentalement marqué par une absence – une séparation primordiale qui survient dès l’entrée dans le langage. La peur de l’abandon est ainsi enracinée dans une quête illusoire d’unité avec l’Autre, une unité qui, en réalité, est impossible à réaliser. Toute relation, en ce sens, porte en elle la possibilité de l'abandon, car elle est fondée sur un manque impossible à combler.
Personnellement, je n’ai plus de doudou depuis longtemps et pour remédier à cet état de manque, cette peur d’être abandonné, j’aime poser ma tête sur le ventre de ma femme : c’est rassurant et plus profond, plus satisfaisant qu’un hug.

Le 22/09/2024
L’objet de DS2C est, depuis 2014, d’étudier le passage à l’acte et de développer une véritable expertise dans, ce qu’on appelle en psycho : l’agir et ses motivations. La base de ce travail d’expertise repose sur une approche générale et clinique. Développer ses connaissances et se documenter parmi les théories actuelles ou qui ont déjà été éprouvées est une nécessité.
A ce titre, je vous propose donc de découvrir la théorie de l’affect, de Silvan Tomkins. Bien moins connue que celle de Paul Ekman, elle est néanmoins pour moi une des bases solides qui sert à s’expliquer une partie du passage à l’acte délictuel/criminel. Elle s’inscrit dans une perspective darwiniste que je revendique.
La théorie de l’affect de Silvan Tomkins, développée dans les années 1960, met l’accent sur les affects en tant que réponses physiologiques qui influencent le comportement humain de manière fondamentale. Cette approche est souvent comparée aux travaux de Paul Ekman en raison de leurs efforts communs pour comprendre les émotions humaines universelles.
Mais leurs théories diffèrent dans leur conceptualisation de l’émotion, leur approche des affects et leurs méthodes de recherche.
Les fondements de la théorie de l'affect de Silvan Tomkins
Tomkins a développé une théorie très originale et complète des affects, qu’il définit comme « des réponses biologiques précoces et essentielles aux stimuli environnementaux ». Contrairement à d'autres approches psychologiques qui considèrent l'émotion comme un sous-produit du cognitif ou comme une réponse secondaire à des événements extérieurs, Tomkins place l’affect – l’émotion - au centre de l’expérience humaine. Tomkins soutient que les affects sont des mécanismes de motivation pour l’homme. Ils constituent un système qui oriente le comportement et permet à l'individu d'interagir avec son environnement de manière adaptative. Tomkins identifie neuf affects de base, qui sont des réponses physiologiques caractéristiques à des situations ou des stimuli spécifiques :
- La surprise (ou l’étonnement)
- La peur (ou la terreur)
- Le dégoût
- Le mépris
- La colère (ou la rage)
- La tristesse (ou l’angoisse)
- La joie (ou l’excitation)
- L’intérêt (ou la curiosité)
- La honte (ou l’humiliation)
Ces affects sont universels, présents chez tous les humains dès la naissance, et régulent l’interaction entre l'individu et son environnement.
Pour Tomkins, les affects se manifestent par des changements visibles et mesurables dans la physionomie, notamment dans l'expression faciale, et sont accompagnés d'une activation autonome (par exemple, une accélération du rythme cardiaque ou une montée d'adrénaline). L'affect se traduit par des réponses physiques reconnaissables.
L’un des aspects clés de sa théorie, c’est son insistance sur le fait que les affects ne sont pas seulement des réponses aux stimuli externes mais ils jouent un rôle dans la régulation de l’attention, augmentant ou diminuant la conscience de certaines situations, et influencent ainsi la manière dont les individus interagissent avec leur environnement et les autres.
Un élément central de la théorie de Tomkins est le concept de script. Les scripts sont des schémas comportementaux que les individus construisent au fil du temps en réponse à des affects récurrents. Chaque individu développe des scripts basés sur ses expériences affectives, qui guident son comportement futur. Par exemple, si un individu associe souvent l’affect de la honte à certaines interactions sociales, il peut développer un script qui l’incite à éviter ces situations à l’avenir.
Les scripts sont donc des moyens d’organiser les expériences affectives et d’anticiper les réponses à des événements futurs. Ils permettent aux individus de donner un sens à leurs expériences émotionnelles et de développer des stratégies d'adaptation.
Comparaison avec la théorie des émotions de Paul Ekman
Paul Ekman est largement reconnu pour ses travaux sur les émotions et l’expression faciale. Bien que Tomkins et Ekman partagent une vision selon laquelle certaines émotions sont universelles, ils diffèrent dans leur approche et leur méthodologie. Il est donc pertinent d’analyser en profondeur les points de convergence et de divergence entre les deux théories.
Ekman, influencé par les travaux de Charles Darwin, a cherché à prouver que certaines émotions sont universelles et se manifestent de la même manière dans toutes les cultures humaines. Grâce à ses recherches sur les expressions faciales, Ekman a identifié six émotions de base universelles :
- La joie
- La tristesse
- La peur
- La colère
- Le dégoût
- La surprise
Ces émotions, tout comme les affects de Tomkins, sont considérées comme innées et partagées par toutes les cultures humaines. Ekman a utilisé des méthodes d'observation des expressions faciales à travers différentes cultures pour démontrer l'universalité de ces émotions.
De ce point de vue, la théorie des émotions d'Ekman est similaire à celle de Tomkins, dans la mesure où les deux théoriciens s’accordent sur le caractère universel de certaines réponses émotionnelles humaines.
L'approche cognitiviste d'Ekman versus la théorie affective de Tomkins
L’une des différences fondamentales entre les deux théories réside dans leur approche de l'émotion. Pour Ekman, les émotions sont principalement des réponses cognitives à des événements spécifiques. Elles sont déclenchées par des évaluations conscientes ou inconscientes de l’environnement. Par exemple, une émotion comme la peur est déclenchée par la perception d'un danger imminent.
En revanche, Tomkins insiste sur le fait que les affects ne nécessitent pas de processus cognitif pour se déclencher. Pour lui, l’affect précède la cognition. Par exemple, un individu peut ressentir de la colère avant même de comprendre pourquoi il est en colère. Tomkins voit l'affect comme une réponse immédiate et automatique qui précède toute réflexion consciente.
Les deux théories accordent une grande importance aux expressions faciales comme indicateurs des émotions. Cependant, leurs interprétations diffèrent. Ekman a développé le système d'encodage facial (Facial Action Coding System - FACS), une méthode pour identifier les émotions humaines à travers l’analyse précise des mouvements des muscles faciaux. Il soutient que chaque émotion de base est associée à une expression faciale spécifique.
Tomkins, de son côté, a également souligné l'importance des expressions faciales, mais il s'est davantage concentré sur la manière dont les affects sont intrinsèquement liés à l'activation physiologique, y compris l'expression faciale. Pour lui, les affects sont des réponses biologiques globales qui incluent, mais ne se limitent pas, aux expressions faciales.
Un autre point de divergence entre Tomkins et Ekman est la place que l'affect ou l'émotion occupe dans la motivation du comportement. Ekman traite les émotions comme des réponses à des stimuli et les considère principalement comme des indicateurs d'états mentaux. En revanche, pour Tomkins, l'affect est le moteur primaire du comportement humain. Il est la force sous-jacente qui motive toutes les actions, pensées et interactions sociales.
Les théories de Tomkins et Ekman ont toutes deux fait l'objet de critiques et de révisions à mesure que la recherche en psychologie émotionnelle a progressé. Tomkins a été critiqué pour son insistance sur l’aspect biologique des affects, certains psychologues estimant que son approche négligeait l'influence des facteurs sociaux et culturels. De plus, sa classification des affects a été jugée simpliste par certains chercheurs, qui ont argumenté que les émotions humaines ne peuvent être réduites à une liste restreinte.
De son côté, Ekman a également fait l'objet de critiques, notamment pour sa focalisation excessive sur l'universalité des émotions, au détriment des variations culturelles et individuelles dans l'expression et la compréhension des émotions.
Cependant, ces deux théories continuent d'influencer profondément le domaine de la psychologie des émotions. Les travaux récents en neurosciences affectives et en psychologie sociale ont montré que les deux approches – celle de Tomkins, centrée sur l’affect, et celle d'Ekman, centrée sur l’émotion et l’expression faciale – peuvent être complémentaires. Certains chercheurs modernes combinent ces perspectives pour offrir une compréhension plus nuancée des émotions humaines.
En conclusion
La théorie de l'affect de Silvan Tomkins et la théorie des émotions de Paul Ekman sont deux approches majeures et influentes pour comprendre la nature des émotions humaines. Alors qu'Ekman a mis l'accent sur l'universalité des expressions faciales et sur les émotions comme réponses cognitives, Tomkins a proposé une vision plus biologique et corporelle des affects comme mécanismes de motivation. Ces différences reflètent des conceptions distinctes de la manière dont les individus interagissent émotionnellement avec leur environnement, mais elles peuvent aussi être vues comme des approches complémentaires plutôt qu’opposées.

Affaire Mazan : profil de Dominique PELICOT
Le 14/09/2024
Comment en vient-on à violer et à faire violer sa femme ?
Un passage à l’acte criminel est une articulation multiple et réciproque impliquant le sujet (le criminel), son histoire de vie, son mode de fonctionnement psychique, ses relations interpersonnelles et son environnement social ; selon un axe de la position subjectivée de l’auteur, un axe du mode opératoire et un axe environnemental.
L’agir violent/criminel est une réponse à une excitation (psychique). C’est une des voies possibles de recours qui cherche à donner forme à des expériences (donc issues du passé) traumatiques, figées et non subjectivées. Subjectiver ça veut dire intégrer l’expérience traumatique et travailler dessus afin de pouvoir la dépasser et reprendre sa vie normalement mais avec cette expérience vécue.
La répétition du traumatisme (passé et non « digéré ») par un passage à l’acte (agir) violent répéterait également l’échec de sa subjectivation, de son élaboration. Le passage à l’acte est alors vu comme le seul moyen rapide et peu gourmand en effort et offrant une issue favorable à la tension (psychique) et donc un retour à l’équilibre psychologique (principe d’homéostasie) salvatrice.
Nous pouvons donc constater une pauvreté des capacités de représentation, de symbolisation et de déplacement de la part de ce type de criminel.
Dans une perspective freudienne, il existe deux modes de jouissance qui traduisent la peur d’anéantissement et le sentiment de toute puissance :
- Le stade anal précoce dont l’érotisme anal est lié à l’évacuation et la pulsion sadique à la destruction de l’objet,
- Le stade anal tardif dont l’érotisme anal est lié à la rétention et la pulsion sadique au contrôle de l’objet.
Ceci explique la nature caractérielle de ce type de criminel. Pour Bergeret, le « bon » objet dans le transfert dépressif (c’est-à-dire que l’individu transfert chez l’autre son état d’angoisse) est un objet (terme psychologique : comprendre là, une personne) pouvant être gratifiant, rassurant et un objet pouvant être menaçant concomitamment.
Mais comment un tel pervers peut-il passer sous les radars, même de sa propre famille ?
Pour Bergeret, il y aurait juste assez de fantasmes pervers discrets pour obtenir le plaisir en trompant le vrai plaisir du « ça » (le « ça » est une instance psychologique qui représente les pulsions de l’individu) par une réalisation demeurant d’allure sexuelle banale sur le plaisir manifeste.
Ces pseudos réponses aux pulsions sexuelles opéreraient une tricherie semblable, parallèle et complémentaire en mystifiant les objets (comprendre les personnes), ou même les simples observateurs extérieurs, dans la mesure où leur serait caché le véritable détonateur pervers du plaisir obtenu. Donc, ces petites accommodations sexuelles entre adultes consentants restent entre quatre murs et les apparences sont sauvées.
Ce caractère pervers, car il s’agit bien de cela et non de « perversité » au sens psychiatrique du terme (paraphilie), repose/correspond à un fonctionnement non pathologique basé sur une organisation mentale perverse de type narcissique-phallique sans avoir besoin de passages à l’acte impliquant des éléments pervers.
Donc, sous couvert d’une vie relationnelle en apparence sans grand conflit et sans grand bruit, une vie normale, grâce d’une part à des choix de personnes (victimes) qui s’y prêtent et grâce aussi à un pourcentage d’éléments sadiques et partiels suffisants pour permettre un jeu sexuel manifeste adapté aux conditions extérieurs dites « normales », le pervers de caractère peut aisément passer une vie relativement tranquille et être vu comme « le bon père de famille » (peut-être faut-il interroger l’intimité de la conjointe, le récit de son intimité pourrait bien modifier la vision idéalisée du « bon père de famille »). C’est un peu le : « dis-moi comment tu baises, je te dirai qui tu es ! »
Le pervers narcissique a donc besoin d’une « complice à ses dépens », naïve, candide, crédule pour pouvoir décharger ses tensions psycho-sexuelles et pouvoir toujours se voir grandiose. Au début de cette dynamique, le pervers va utiliser des moyens assez simples à mettre en place ou à pratiquer. Ce sont des attouchements, des caresses volées, des actes sexuels (sur partenaires consentantes) appuyés voire brutaux pour aller crescendo au fur et à mesure du développement de sa confiance en lui.
C’est ce qu’il s’est passé avec Dominique PELICOT. On n’en vient pas à ces pratiques extrêmes sans s’être un peu exercé, ni sans avoir développé un modus operandi bien carré ! Cependant, on oubli trop souvent ce fameux « grain de sable » qui vient casser cette belle machine.
Le sujet criminel se contente de dénier à l’autre le droit de posséder son propre narcissisme. Les objets, les autres personnes dont le pervers se sert pour assouvir ses besoins, ne peuvent posséder d’individualité concurrentielle qui ne serait pas centrées sur le pervers lui-même, possessif, intransigeant et exclusif dans ses exigences affectives.
Tout doit être pensé pour lui seul. Les autres sont destinés obligatoirement à compléter son narcissisme défaillant au prix de leur propre narcissisme. Le pervers tient son objet (l’autre) dans une étroite relation anaclitique (forte dépendance) entre sadomasochisme et narcissisme. Il y a une totale absence de souffrance et de culpabilité qui tient à un Surmoi (votre « père fouettard » intérieur) inopérant et à un Moi (instance psychique à laquelle se rattache la conscience et qui communique avec le monde extérieur) faible qui ne peut éviter que les pulsions ne passent par le passage à l’acte (agir). Se pose également le problème de gestion de la frustration…
Mais pourquoi un passage à l’acte si tardif ?
Nous sommes dans une organisation névrotique avec un mode de défense principal de refoulement. La relation à l’objet (à l’autre) est avant tout génitale et sadique. Il n’y a de place ni pour la pitié, ni de plaisir par le sujet lui-même de la souffrance de l’autre. Seule la satisfaction directe de la pulsion entre en ligne de compte.
Bergeret souligne qu’au moment de la sénescence physique, intellectuelle, sociale ou affective, il peut survenir un accès pathologique dramatique, brutal, inattendu, très grave. Cet accès pathologique se déclenche sans traumatisme apparent car la sénescence à elle seule peut constituer ce traumatisme. C’est la décompensation de la sénescence.
La perversion peut se constituer qu’à un moment de la vie. Racamier dit que pour pleinement accomplir une perversion narcissique, il faut à la fois en avoir la nécessité profonde mais également l’opportunité. Le pervers de caractère va donc créer/construire tout au long de sa vie, ou à un moment angoissant de sa vie, ces conditions nécessaires à un passage à l’acte violent.
La perversion de caractère n’est pas accompagnée de trouble sexuel. C’est un moyen de faire l’économie d’un travail psychique et de le transférer sur quelqu’un d’autre. Eiguer dit que le Moi grandiose cache un sentiment d’infériorité et de dépendance excessive vis-à-vis de l’admiration et des approbations extérieures. Le pervers de caractère va donc nourrir son amour propre en se servant de l’autre qui est ainsi vu comme un « non-objet » ou un « non-individu » érotisé.
Sans l’autre, il n’est plus rien !
Lien vers la vidéo qui montre l’intervention du vigile qui a remarqué la caméra cachée dans une sacoche de Dominique PELICOT. Grâce à son intervention et à son sens de l’observation, il a permis son arrestation :
Viols de Mazan : la vidéo qui a permis de révéler l'affaire (francetvinfo.fr)
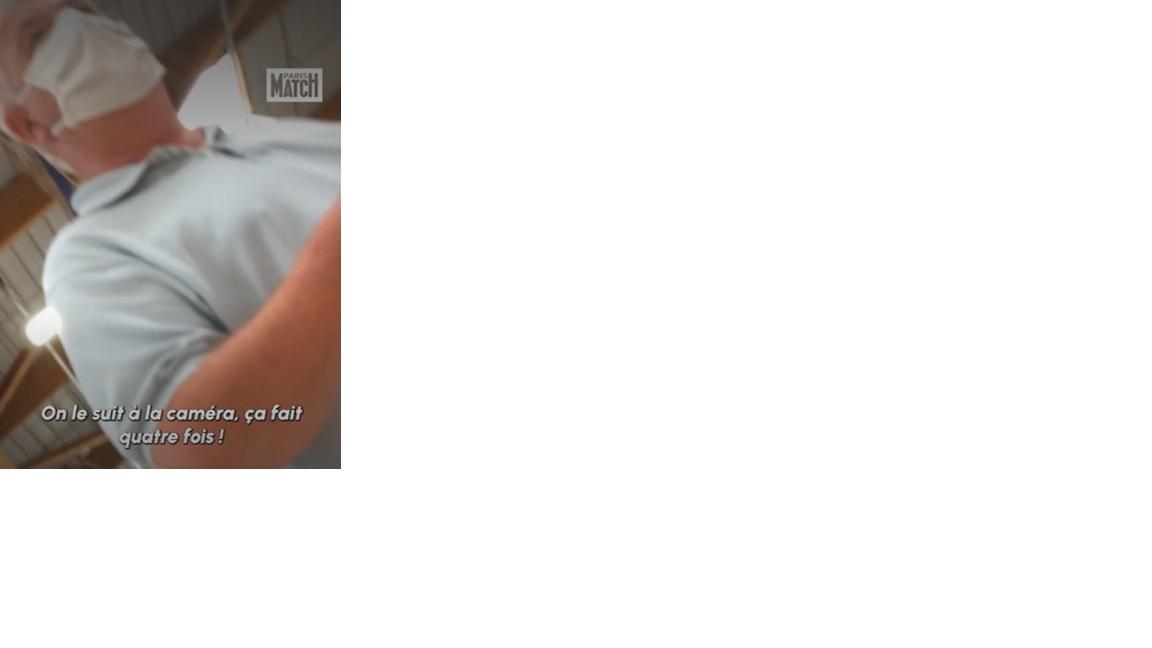
"Mais pourquoi je n'arrive pas à m'endormir ?"
Le 04/08/2024
« Mais pourquoi je n’arrive pas à m’endormir ? »
C’est une question récurrente que beaucoup de personnes se posent. Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi certaines personnes n’arrivent pas à s’endormir le soir. Je ne vais pas aborder à nouveau ces facteurs dans cet article, et encore moins l’aspect environnement, les écrans etc… je les ai précédemment développés dans un précédent article.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’il existe une relation symbolique entre le sommeil et la mort. Cette perspective trouve ses racines dans diverses traditions culturelles, littéraires et psychanalytiques.
Symbolisme du sommeil et de la mort
Dans de nombreuses cultures, le sommeil est souvent décrit comme une forme de « petite mort. » Cette analogie repose sur l’idée que le sommeil implique une perte de conscience temporaire, semblable à la perte de conscience permanente que représente la mort.
Hypnos et Thanatos : une association traditionnelle renouvelée à la Renaissance | Cairn.info
Peurs inconscientes
Selon la psychanalyse, le sommeil pourrait être associé à des peurs inconscientes de la mort. Pour certaines personnes, l’idée de s’abandonner au sommeil peut raviver des angoisses profondes liées à la mortalité, à la perte de contrôle ou à l’inconnu.
Freud et le principe de la mort
Sigmund Freud a exploré l’idée que certains individus peuvent avoir des résistances inconscientes au sommeil en raison de la peur de la mort. Dans ses théories sur l’inconscient, il décrit des pulsions de vie et de mort qui peuvent influencer de manière subtile et complexe. Freud a proposé l’existence de deux forces fondamentales dans la psyché humaine : Eros (la pulsion de vie) et Thanatos (la pulsion de mort). Selon cette théorie, certains comportements, y compris les troubles du sommeil, pourraient être des manifestations de ces forces en conflit. La résistance à l’endormissement pourrait être vue comme une lutte contre la pulsion de mort, une tentative de la psyché de se protéger contre l’angoisse existentielle liée à la fin de la conscience.
Expériences traumatiques
Les personnes ayant vécu des expériences traumatisantes, notamment des expériences de mort imminente ou la perte de proches, peuvent développer des associations négatives avec le sommeil. La peur de revivre des souvenirs traumatiques ou d’être vulnérable pendant le sommeil peut rendre l’endormissement difficile. Le sommeil, en devenant un moment où ces souvenirs traumatiques peuvent refaire surface, devient une source de stress et d’angoisse plutôt qu’un refuge réparateur.
Théories existentielles
D’un point de vue existentiel, l’angoisse liée à la condition humaine et à la conscience de la mortalité peut se manifester sous forme d’insomnie. Les réflexions sur la vie, la mort, et le sens de l’existence peuvent devenir plus prononcés la nuit, quand l’esprit n’est pas distrait par les activités diurnes.
Ces perspectives soulignent que, pour certaines personnes, les difficultés d’endormissement peuvent être profondément enracinées dans des symbolismes psychologiques et des peurs existentielles liées à la mort. Ces enjeux peuvent être explorés et traités à travers des approches thérapeutiques comme la psychanalyse ou la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Une exploration plus approfondie de ces aspects symboliques et inconscients peut être nécessaire pour comprendre et traiter les problèmes de sommeil de manière holistique.
L’importance de l’étayage parental à travers la vie d’Armin Meiwes
Le 21/07/2024
Armin Meiwes : une vie marquée par l’horreur
Enfance et relations familiales
Surnommé « le cannibale de Rotenburg », Armin Meiwes est né le 1er décembre 1961 à Kassel, en Allemagne. Sa jeunesse a été marquée par une relation difficile avec ses parents. Son père, un policier autoritaire, était souvent absent et a fini par quitter la famille lorsque Armin avait huit ans. Cette séparation a eu un impact profond pour lui, le laissant avec un sentiment d’abandon. Sa mère décrite comme possessive et dominante, a élevé Armin dans un environnement strict, le contrôlant étroitement. Isolé, Armin développait un monde imaginaire où il se réfugiait pour échapper à la solitude et à la rigueur de sa vie domestique.
Scolarité et adolescence
Armin Meiwes était un élève moyen, mais il n’avait pas beaucoup d’amis. Ses camarades de classe le décrivaient comme un garçon timide et introverti. A l’adolescence, il commença a fantasmer sur le cannibalisme, utilisant ces pensées pour combler son besoin d’intimité et de contrôle, conséquences directes de son éducation perturbée.
Les circonstances du crime
Les fantasmes d’Armin Meiwes se sont intensifiés avec le temps, jusqu’à ce qu’il passe à l’acte en 2001. Il publia une annonce sur un forum en ligne dédié aux fétiches extrêmes, recherchant un volontaire pour être tué et consommé. A la surprise générale, un homme du nom de Bernd Jürgen Brandes répondit favorablement.
Le 9 mars 2001, Brandes se rendit au domicile de Meiwes à Rotenburg. Les deux hommes eurent des relations sexuelles avant que Meiwes ne coupe le pénis de Brandes, un acte que ce dernier avait souhaité. Brandes saigna abondamment mais, sous l’effet de puissants sédatifs, il continua à coopérer jusqu’à ce qu’il perde connaissance. Meiwes, selon ses propres aveux, attendit plusieurs heures avant de le tuer en lui tranchant la gorge. Il enregistra la totalité de l’acte sur vidéo, un élément clé lors de son procès.
Conséquences légales et psychologiques
Armin Meiwes fut arrêté en décembre 2002 après que la police eut découvert la vidéo du meurtre. Son procès, qui débuta en décembre 2003, attira une attention internationale en raison de la nature macabre du crime. Meiwes fut d’abord condamné à huit ans et demi de prison pour homicide involontaire, la cour considérant que Brandes avait consenti à sa propre mort. Cependant, après un appel, il fut rejugé en 2006 et condamné à la perpétuité pour meurtre et perturbation de la paix des morts.
Le cas d’Armin Meiwes soulève des questions profondes sur les limites du consentement et les aspects psychologiques de comportements extrêmes. Son enfance marquée par l’isolement et une relation dysfonctionnelle avec ses parents, combinée à des fantasmes déviants, ont abouti à un crime qui restera dans les anales de la criminologie moderne.
Pourquoi, selon Bowlby, l’étayage maternel est-il si important pour le petit enfant ?
Selon John Bowlby, l’étayage maternel, ou l’attachement à la figure maternelle, est crucial pour le développement psychologique et émotionnel du petit enfant pour plusieurs raisons fondamentales :
- Sécurité émotionnelle : la présence constante et rassurante de la mère ou de la figure d’attachement principale fournit à l’enfant un sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité est essentiel pour que l’enfant puisse explorer son environnement en toute confiance, sachant qu’il peut revenir à une base sûre en cas de besoin.
- Développement de la confiance : l’attachement sécurisant permet à l’enfant de développer une confiance en lui-même et en ses capacités. La mère, en répondant de manière prévisible et sensible aux besoins de l’enfant, aide celui-ci à comprendre qu’il est digne d’amour et de soin, ce qui favorise une estime de soi positive.
- Régulation des émotions : les interactions avec la figure d’attachement aident l’enfant à apprendre à réguler ses émotions. Par exemple, lorsque l’enfant est stressé ou effrayé, la présence et les réponses apaisantes de la mère aident à calmer l’enfant, lui enseignant progressivement comment gérer ses propres émotions.
- Modèles de relations futures : l’attachement initial sert de modèle pour toutes les relations futures de l’enfant. Un attachement sécurisant favorise des relations interpersonnelles saines et stables à l’âge adulte, tandis qu’un attachement insécurisant peut mener à des difficultés relationnelles.
- Base de développement cognitif : un environnement sécurisant permet à l’enfant de se concentrer sur l’apprentissage et l’exploration plutôt que sur la survie ou la recherche de réconfort. Cela encourage le développement cognitif et la curiosité, facilitant l’acquisition de nouvelles compétences et connaissances.
- Prévention des troubles psychologiques : un attachement sécurisant est associé à une moindre prévalence de troubles psychologiques. Les enfants qui ont bénéficié d’un bon étayage maternel sont moins susceptibles de développer des troubles de l’anxiété, de la dépression, ou des problèmes de comportement.
En résumé, l’étayage maternel est fondamental car il forme la base sur laquelle l’enfant peut construire sa compréhension du monde, développer des compétences émotionnelles et sociales, et établir des relations saines et stables tout au long de sa vie.

Le 10/07/2024
Selon Freud, le processus de création d'un rêve comporte trois phases : la condensation, le déplacement et la figuration symbolique. En combinant ces trois phases, Freud croyait que les rêves étaient une voie royale vers l'inconscient et pouvaient révéler des désirs refoulés et des conflits internes.
- La condensation se réfère au fait que plusieurs idées, émotions ou désirs peuvent être combinés en une seule image ou scène dans un rêve. Cela peut rendre la signification du rêve plus complexe et difficile à interpréter.
- Le déplacement se produit lorsque l'énergie émotionnelle associée à un désir ou à une pensée est déplacée vers un autre objet ou personne dans le rêve. Cela peut conduire à des associations inattendues et à des symboles qui ne sont pas directement liés à la source originale du désir.
- La figuration symbolique se réfère à la représentation symbolique des désirs inconscients dans le rêve. Les symboles utilisés peuvent être personnels et avoir une signification spécifique pour le rêveur, ce qui rend l'interprétation des rêves souvent subjective.
Pourquoi est-ce si important de rêver (et d’essayer de s’en souvenir) ?
- Exutoire pour les désirs inconscients : Les rêves sont une voie royale vers l'inconscient. Ils permettent d'exprimer des désirs refoulés qui ne peuvent pas être réalisés dans la vie éveillée. Les rêves servent de soupape de sécurité, permettant à ces désirs de se manifester sous une forme symbolique, réduisant ainsi la tension psychique.
- Processus de régulation émotionnelle : Les rêves aident à réguler les émotions en permettant aux individus de traiter des expériences et des sentiments complexes. Ils peuvent aider à digérer des événements stressants ou traumatiques, contribuant ainsi à une meilleure santé mentale.
- Résolution de problèmes : Les rêves peuvent jouer un rôle dans la résolution de problèmes en offrant des perspectives nouvelles ou inattendues. Pendant le rêve, l'esprit peut faire des connexions libres, ce qui peut mener à des solutions créatives que l'individu n'aurait pas envisagées dans l'état de veille.
- Consolidation de la mémoire : La recherche contemporaine montre que les rêves participent à la consolidation de la mémoire. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau traite et organise les informations de la journée, intégrant les souvenirs à long terme.
- Auto-réflexion et développement personnel : Les rêves permettent une forme d'introspection et de compréhension de soi. En interprétant ses rêves, un individu peut mieux comprendre ses motivations, ses peurs et ses désirs, facilitant ainsi la croissance personnelle.
- Maintien de l'équilibre psychologique : Freud croyait que les rêves maintiennent l'équilibre psychologique en offrant un espace où les conflits internes peuvent être mis en scène et travaillés de manière symbolique. Cette fonction cathartique aide à préserver la santé mentale.
- Expression créative : Les rêves peuvent être une source d'inspiration créative. De nombreux artistes, écrivains et scientifiques ont puisé dans leurs rêves pour obtenir des idées innovantes et des œuvres d'art.
En résumé, rêver est une activité essentielle qui joue plusieurs rôles importants dans la vie psychique d'un individu, allant de la régulation émotionnelle et la consolidation de la mémoire à l'expression des désirs inconscients et la résolution créative de problèmes.
Est-ce que s'ennuyer n'est pas similaire à rêver ?
L'ennui et le rêve sont deux états de conscience distincts, mais ils partagent certaines similitudes en termes de processus cognitifs impliqués.
Quelles sont les différences entre ces deux états ?
- Etat de conscience :
- Rêve : Les rêves se produisent principalement pendant le sommeil paradoxal (REM), un état de conscience altéré où l'esprit est actif mais le corps est paralysé.
- Ennui : L'ennui se produit lorsque l'individu est éveillé et conscient, mais éprouve un manque de stimulation ou d'intérêt pour son environnement ou ses activités.
- Nature des Expériences :
- Rêve : Les rêves sont des expériences mentales souvent vives et complexes, impliquant des scénarios imaginaires, des symboles et des émotions intenses.
- Ennui : L'ennui est une expérience de vide ou de désintérêt, où l'esprit peut vagabonder, mais sans la structure narrative ou émotionnelle intense des rêves.
- Objectifs et Fonctions :
- Rêve : Les rêves ont des fonctions spécifiques comme la consolidation de la mémoire, la régulation émotionnelle et l'expression des désirs inconscients.
- Ennui : L'ennui pousse l'individu à rechercher des stimuli ou des activités plus intéressantes et peut encourager la réflexion et la créativité comme moyen de sortir de cet état.
Quelles sont les similitudes entre ces deux états ?
- Vagabondage de l'Esprit :
Dans les deux états, l'esprit peut errer librement, explorant des pensées et des idées sans contrainte. Cela peut mener à des associations libres et des idées créatives, bien que les rêves tendent à être plus structurés et narratifs.
- Processus Cognitifs :
Les deux impliquent des processus cognitifs similaires tels que l'imagination, la mémoire et l'association d'idées. Le vagabondage mental pendant l'ennui peut parfois conduire à des états de rêve éveillé ou de rêverie diurne, où les pensées deviennent plus fluides et moins structurées.
- Réflexion et Introspection :
L'ennui, tout comme le rêve, peut fournir un espace pour l'introspection et la réflexion personnelle. En l'absence de stimulation externe, l'esprit peut se tourner vers l'intérieur, permettant une exploration des pensées et des sentiments.
Conclusion
Bien que l'ennui et le rêve soient des états de conscience distincts, ils partagent certaines similitudes dans les processus cognitifs impliqués, comme le vagabondage de l'esprit et l'utilisation de l'imagination et de la mémoire. Cependant, les fonctions spécifiques et les contextes dans lesquels ils se produisent sont différents. Les rêves ont des fonctions psychologiques et biologiques spécifiques liées au sommeil, tandis que l'ennui agit comme un signal pour chercher des stimulations nouvelles et peut inciter à la créativité et à la réflexion.

Le passage à l'acte criminel en 4 phases
Le 26/05/2024
Si l’on parvient à découvrir les conditions du passage à l’acte, il sera possible de recenser les syndromes de l’état dangereux, ces faisceaux de symptômes qui alertent le criminologue sur la probabilité d’un dénouement délictueux.
Le passage à l’acte n’a que l’apparence de la soudaineté. Le crime n’est qu’une longue patience, résultat d’une morne application quotidienne, souvent inconsciente, du criminel, et d’une conjonction de circonstances funestes. Selon Pinatel, « le crime est la réponse d’une personnalité à une situation ».
Égocentrisme, labilité, agressivité, indifférence affective, tels sont les quatre caractères fondamentaux de la personnalité qui sous-tendent le passage à l’acte.
Lorsqu’ils étudient les facteurs mésogènes, les criminologues font une distinction entre le « milieu du développement », qui influence la formation et l’évolution de la personnalité (la famille, les groupes sociaux, etc.), et le « milieu du fait », c’est-à-dire les situations dans lesquelles est placé le délinquant au moment de son crime. C’est ce milieu du fait qui joue un rôle plus ou moins important dans le déclenchement du passage à l’acte.
Le « milieu » désigne l’ensemble des facteurs extérieurs, matériels et moraux (environnement, climat, cadre), qui entourent et conditionnent un individu. Réciproquement l’individu agit sur son milieu. Par métonymie, le terme est employé comme équivalent de « monde » ou de « groupe social » (classe, famille, profession). Il signale alors la cohérence et la relative clôture d’un groupe, dont les éléments sont soumis à des influences et à des lois communes.
Le processus qui conduit à l’accomplissement de l’acte grave comporte quatre phases principales :
- la phase de 1’assentiment inefficace,
- la phase de 1’assentiment formulé,
- la phase de la crise,
- et le dénouement.
L’élément essentiel de ce processus est le « devenir » du sujet : ce que le criminel est devenu psychologiquement, généralement sans le savoir, devenir qui n’est perceptible que dans une étude portant sur une longue durée, car seule la durée permet de saisir l’évolution ou la stagnation.
L’étape initiale de l’assentiment inefficace est l’aboutissement d’un lent travail inconscient. Une occasion quelconque révèle au sujet « un état souterrain préexistant » : un rêve, la lecture d’un fait divers, une conversation, un film ou toute autre circonstance lui fait entrevoir par une sorte d’association d’idées ce que, sans le savoir encore clairement, il souhaitait vaguement depuis quelque temps, par exemple la disparition de son conjoint, dont il est las. Il accepte alors l’idée de cette disparition possible. Mais la mort de son conjoint est représentée dans son esprit comme un phénomène objectif dans lequel il ne prend personnellement aucune part. La mort n’est pas son œuvre ; il imagine qu’elle puisse résulter de la nature des choses, d’un accident de la route, d’une maladie, d’un cataclysme, d’un suicide... Mais il envisage cette possibilité sans déplaisir : acquiescement encore inefficace, puisque le sujet ne se représente pas encore en tant qu’auteur de ce drame.
Dans la plupart des cas, la velléité homicide très indirecte et très détournée s’arrête là, car l’équilibre est vite rétabli par une réaction morale. Mais quelquefois cela va plus loin. L’assentiment, d’inefficace, devient alors un acquiescement formulé. Tout en continuant à s’efforcer de penser que la disparition pourra s’accomplir sans son concours, le sujet commence à se mettre lui-même en scène en tant qu’adjuvant de l’œuvre destructrice. Mais la progression de cette idée passe par des hauts et des bas. Le travail de dévalorisation de la victime alterne avec l’examen des inconvénients du crime. A ce stade, « un rien peut faire accomplir un bond prodigieux en avant ou susciter une fuite éperdue ». Le crime peut même survenir prématurément au cours de cette période, alors que la préparation du criminel n’est pas complète ou qu’il n’a pas eu le temps ou la hardiesse « de se regarder lui-même ». Une ivresse, une discussion, un événement hors série, une occasion exceptionnelle offerte par le hasard précipitent les choses. C’est ici, note De Greeff, que pourront se situer des actes mal exécutés ou dont l’éclosion apparemment soudaine trompera la justice sur leur véritable signification (processus d’acte subit et irréfléchi). Mais, souvent, le dénouement est précédé d’une crise.
La crise est le signe que l’homme « marche à reculons » vers un acte aussi avilissant qu’un crime. Il ne s’y détermine qu’après une véritable « agonie morale ». Il faut qu’il se mette d’accord avec lui-même, qu’il légitime son acte. Plus il est « stabilisé dans des pratiques morales lui enjoignant la réprobation d’un tel acte, et plus il lui faudra de temps pour s’adapter à cette déchéance ». Quelques criminels cependant, pour surmonter cette pénible crise, s’imposent à eux-mêmes un processus avilissant « en se créant une personnalité pour qui le crime ne soit plus une chose grave et tabou ».
Après le dénouement, on constate généralement un changement d’attitude. Le délinquant, qui se trouvait auparavant dans un état d’émotivité anormale va manifester, selon les cas, un soulagement, des regrets, de la joie ou de l’indifférence. « Toute la personnalité du criminel se trouve condensée à ce moment-là. »
La réaction d’indifférence ou de désengagement, si bien décrite par De Greeff, se rencontre chez les criminels qui, ayant longuement vécu la préparation psychologique de leur acte, considèrent le résultat comme une conclusion logique de leur projet. Ils ont fait ce qu’ils voulaient accomplir et ils n’éprouvent pas le besoin de dramatiser davantage.
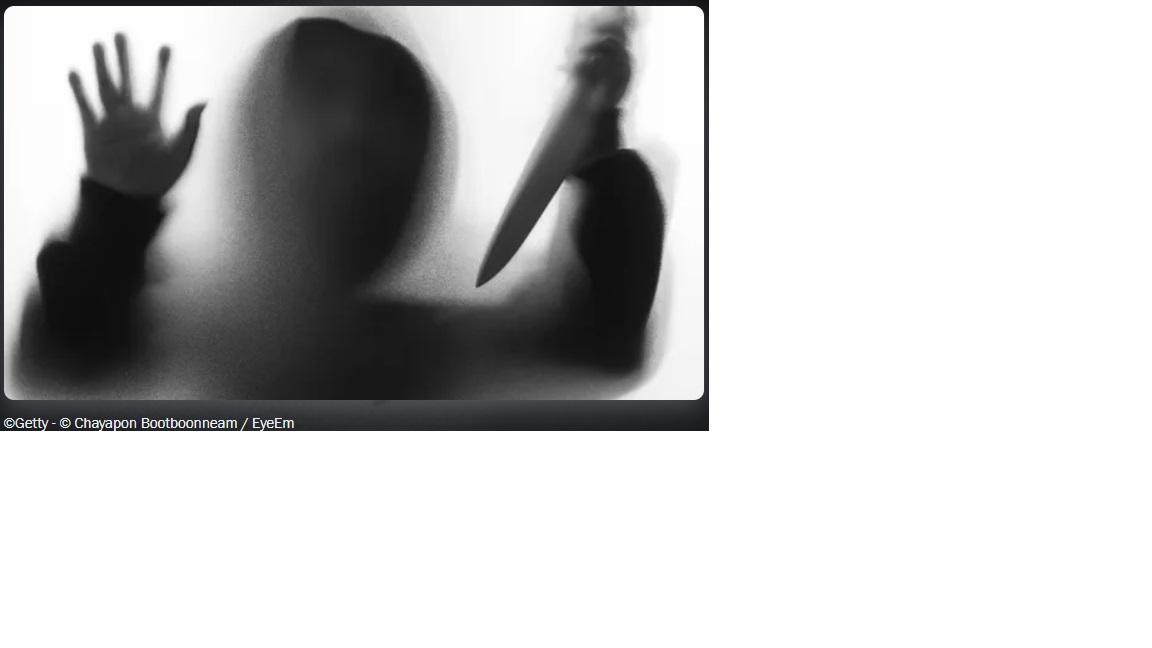
Sources :
Mathilde Barraband, « Milieu », dans Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le lexique socius, URL : http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/34-milieu
La théorie de la contrainte non choisie, où : pourquoi dire "non" ?
Le 09/05/2024
Il existe un lien de cause à effet entre ne pas savoir dire « non » et le harcèlement moral et affectif.
Ce lien, nous le subissons tous mais à divers degrés. C’est pour cela que certaines personnes sont plus affectées que d’autres.
Ce lien est subtil, implicite, ténu voire malsain. C’est ce que j’appelle la théorie de la contrainte non-choisie. C’est le fait d’imposer à l’autre une tâche, un service alors qu’il existe d’autres possibilités. C’est rendre l’autre redevable pour se déresponsabiliser et se placer en position de dominant, pour avoir un ascendant sur l'autre.
Par exemple, un petit groupe de personnes reviennent d’un café et l’une d’elles (personne A) demande à une autre (personne B) de lui déposer son téléphone et son gobelet de boisson à son bureau, le temps qu’elle se rende aux toilettes. Ça s’apparente à un service tout à fait banal, mais l’autre possibilité eut été que la personne A dépose elle-même ses affaires à son bureau pour aller ensuite aux toilettes, sans avoir à solliciter la personne B.
Si la personne B accepte de rendre ce service, elle accepte alors implicitement une relation de subordination qui se répètera forcément parce qu’elle sera vue comme serviable. Sauf que si ce type de services se multiplie, cela provoquera un stress chez la personne A qui pourrait devenir délétère à la longue.
Autre exemple avec les aventuriers de Koh-Lanta, lorsqu’au moment des nominations l’un des aventuriers dit à un autre : « j’ai éliminé 2 amis à moi alors que ça me déchirait le cœur. Là, je te demande simplement aujourd’hui de faire la même chose avec untel. »
Ce type de demande crée un lien de subordination insidieux qui vous place en position de devoir effectivement réaliser ce service pour l’autre. Mais comme vous pouvez vous en apercevoir, l’autre n’est pas démuni d’un intérêt personnel, d’une intention qui est manipulatrice pour autant qu’elle n’ait pas d’autre solution que de vous solliciter.
La racine du mot « contrainte » est CONSTRINGERE qui désigne ce qui est enserré par des liens, enchaîné, entravé, dominé. Une contrainte, ce sont des règles attribuées auxquelles le sujet doit se conformer, qui lui indiquent ce qu’il doit ou ne doit pas faire. « La notion de contrainte implicite met l’accent sur les inférences du sujet à partir d’une activité de compréhension des contraintes explicitent (cairn.info). »
Une contrainte choisie rend la personne qui l’accepte actrice de son choix, c’est intentionnel. L’inverse lui confère un rôle passif, de soumission car ce sera un choix non intentionnel.
C’est facilement compréhensible lorsque vous devez signer un contrat de travail ou un prêt financier.
Savoir dire « non » vous permet de ne pas accepter le stress inhérent et possiblement les conséquences qui peuvent en résulter. C’est vous protéger.
